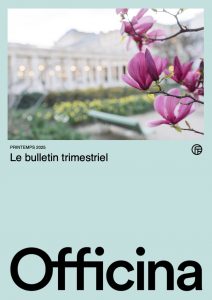Les livrets réglementés comme le Livret A ou le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) permettent de garder une épargne disponible à tout moment, idéale pour vos dépenses courantes ou vos projets à court terme (vos futures vacances par exemple).
Toutefois, leur rendement se contracte de nouveau pour atteindre un taux de 2,4 % par an depuis le 1er février 2025 et la baisse pourrait se poursuivre. Le moment est peut-être opportun pour rediriger une partie de cette épargne vers d’autres solutions. Faisons le point ensemble sur les alternatives qui s’offrent à vous.
L’ASSURANCE VIE : UNE ENVELOPPE FLEXIBLE ET RENTABLE
Le contrat d’assurance vie permet de faire fructifier votre épargne tout en restant disponible, sans limite de montant (contrairement au Livret A et au LDDS qui sont plafonnés). Vous pouvez investir dans des fonds euros ou des unités de compte.
BON À SAVOIR :
Vous pouvez retirer votre argent à tout moment. De plus, les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 4 600 € pour un célibataire ou 9 200 € pour un couple marié ou pacsé, à condition de détenir le contrat depuis plus de 8 ans. Ils restent toutefois soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
Le fonds euros et les livrets réglementés ont pour point commun d’être des supports sécuritaires, car le capital placé est garanti. En revanche, le rendement net du fonds euros progresse et est désormais supérieur à celui des livrets.
Toutefois, ce rendement risque de ne pas suivre l’inflation sur le long terme. Le fonds euros reste une bonne option de sécurité dans vos allocations d’actifs, mais il peut être une solution de transition avant d’investir dans des unités de compte, qui offrent un meilleur potentiel de rendement.
Ces unités de compte vous permettent de profiter du dynamisme des marchés financiers et immobiliers, tout en vous offrant des taux de rendement “bonifiés” sur vos fonds euros. Elles offrent donc un meilleur rendement moyen-long terme, mais comportent des risques de perte en capital. Il est donc important de choisir des supports adaptés à votre profil investisseur.
BON À SAVOIR :
Votre profil investisseur est défini par une série de questions sur votre connaissance des marchés, votre sensibilité au risque (sécuritaire, équilibré ou dynamique), votre capacité à subir des pertes, et vos préférences en matière de critères environnementaux et sociaux.
Parmi ces unités de compte, vous pouvez retrouver :
- des supports immobiliers comme les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) qui investissent dans des secteurs tels que le résidentiel, les bureaux ou la santé, et distribuent des revenus réguliers. Ces revenus profitent par ailleurs de la fiscalité avantageuse de l’assurance vie ;
- des valeurs mobilières (obligations, fonds monétaires ou des actions) pour capter les performances des marchés financiers ;
- ou encore des produits structurés qui combinent une performance liée à l’évolution d’un titre (actions, obligations, etc.) ou un indice (comme le CAC 40) et une protection, partielle ou totale, du capital.
COMPTE-TITRES ET PEA : DEUX OPTIONS À CONSIDÉRER
Le compte-titres et le PEA vous permettent d’accéder à un large éventail de supports financiers : des actions, des OPCVM (fonds d’investissement) ou encore des ETF (appelés aussi trackers, ils reproduisent les performances d’un indice boursier).
- Le compte-titres est très flexible : sans plafond de versement, il permet d’investir en France ou à l’étranger. Votre argent est disponible, mais chaque transaction est imposée :
- au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu ;
- aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
- Le PEA offre une fiscalité plus avantageuse : les transferts d’argent à l’intérieur du plan (arbitrages) ne sont pas imposés. Si vous gardez votre PEA plus de 5 ans, les gains sont aussi exonérés d’impôt sur le revenu. Seuls les retraits d’un plan de moins de 5 ans sont soumis à l’impôt, et entraînent la clôture du plan.
BON À SAVOIR :
Le PEA est réservé aux investissements dans des actions françaises et européennes et est plafonné à 150 000 € de versements. Si vous n’avez pas atteint ce plafond, le PEA peut être une piste à étudier.
Si vous voulez diversifier vos placements dans l’immobilier, les SCPI peuvent être une bonne option.
Ces sociétés vous permettent d’investir, même à partir de faibles montants (contrairement à l’achat direct d’immobilier), dans des biens immobiliers de bureaux, de commerces, d’entrepôts, ou encore de santé, dans différentes zones géographiques (en France ou à l’étranger).
Les sociétés de gestion des SCPI s’occupent de tout : gestion des locataires, réparations, etc. Vous recevez ensuite des revenus réguliers, mais ces derniers sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
En tant que dirigeant de société, vous vous demandez sûrement comment optimiser efficacement votre rémunération ? La question est complexe et mérite un tour d’horizon des solutions possibles.
QUELS SONT LES PRINCIPAUX OUTILS POUR SE RÉMUNÉRER ?
Un dirigeant dispose de plusieurs moyens pour se payer :
- La rémunération du mandat: contrairement à un salarié, le dirigeant ne touche pas de salaire, mais une rémunération versée en contrepartie de l’exercice de ses fonctions de mandataire social. Le montant de cette rémunération doit être fixé dans les statuts de la société, ou chaque année lors de l’assemblée générale.
- Le versement de dividendes: vous percevez les dividendes de la société à la condition d’en être l’un des associés (la plupart du temps, le dirigeant est également associé de la société, mais ce n’est pas obligatoire). C’est la collectivité des associés qui décide, chaque année, du versement ou non du dividende, et de son montant global. Le montant perçu dépend du nombre de parts détenues dans la société.
BON À SAVOIR :
Tout l’enjeu de l’optimisation de la rémunération est de déterminer le montant et le mode optimal de rémunération pour :
- réduire le poids des charges et des impôts pour vous et votre société ;
- tout en vous attribuant suffisamment d’argent pour couvrir vos besoins courants ;
- sans négliger votre protection sociale et votre retraite.
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS LEVIERS D’OPTIMISATION DE LA RÉMUNÉRATION ?
Le statut social du dirigeant influence directement les cotisations sociales et la protection sociale. Le premier levier d’optimisation est donc de choisir le statut social adapté à votre situation.
- 1 – Choisir le bon statut social
C’est la forme de la société que vous allez choisir pour votre activité professionnelle qui déterminera votre statut social.
- Le gérant majoritaire de SARL est un travailleur non salarié (TNS) affilié à ce titre à la Sécurité sociale des indépendants.
- Le président d’une SAS est un assimilé salarié et cotise au régime général de la Sécurité sociale, comme un salarié (à l’exception des cotisations chômage).
BON À SAVOIR : qu’est-ce qu’un gérant majoritaire ?
Le gérant est dit majoritaire lorsqu’il possède seul, ou avec son conjoint / son partenaire, ses enfants mineurs ou les autres co-gérants, plus de 50 % des parts de la SARL. Les gérants égalitaires et minoritaires sont des assimilés salariés.
Les travailleurs non-salariés (TNS) payent moins de cotisations sociales que les assimilés salariés. Ainsi, à rémunération brute équivalente, le TNS touche une rémunération nette plus élevée qu’un assimilé salarié. Mais attention, cette économie a un prix : sa protection sociale est moindre.
Par exemple :
- en matière de retraite: à rémunération brute équivalente, sa retraite sera plus faible qu’en tant qu’assimilé salarié. L’écart se creuse notamment pour les rémunérations supérieures à 190 000 €.
- en cas de décès, d’invalidité ou d’arrêt de travail: là aussi, le TNS est moins bien couvert.
BON À SAVOIR :
Le TNS peut toutefois compenser la différence de protection sociale par des solutions individuelles comme un contrat d’épargne retraite supplémentaire ou une prévoyance Madelin.
À l’inverse, l’assimilé salarié paye davantage de charges sociales sur sa rémunération qu’un travailleur non salarié, sa rémunération nette est donc moins élevée. Mais, en contrepartie, il est mieux protégé socialement.
BON À SAVOIR : et si j’ai choisi le mauvais statut ?
Vous pouvez tout à fait transformer votre société en une autre forme sociale afin de changer de statut. Attention, cela engendre des coûts, il faut donc bien vérifier en amont que le changement de forme sociale et de statut comporte un réel intérêt.
- 2 – Arbitrer entre dividendes et rémunération
Les dividendes sont soumis à des charges fiscales et sociales moins importantes que la rémunération. Ils peuvent bénéficier du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de seulement 12,8 % alors que la rémunération est imposée selon le barème de l’impôt sur le revenu (qui peut aller jusqu’à 45 %). De plus, les dividendes sont soumis aux prélèvements sociaux à 17,2 %, alors que la rémunération est soumise à des cotisations sociales dont le taux est souvent plus élevé.
Attention :
Les dividendes perçus par un travailleur non salarié (TNS) qui dépassent 10 % du capital social sont soumis à cotisations sociales.
Par exemple, un gérant majoritaire d’une SARL au capital social de 10 000 € se verse un dividende de 30 000 € :
- 1 000 € (10 000 € x 10 %) sont soumis aux prélèvements sociaux à 17,2 % ;
- le reste, soit 29 000 € (30 000 – 1 000 €), est soumis aux cotisations sociales.
Les assimilés salariés, quant à eux, ne paient jamais de cotisations sociales sur leurs dividendes, c’est là l’un des attraits de ce statut.
Soyez vigilant ! Il peut être tentant de privilégier une rémunération à 100 % sous forme de dividendes. Toutefois, cette stratégie comporte plusieurs écueils. Tout d’abord, il faut toujours veiller à percevoir des sommes soumises à cotisations sociales suffisantes (rémunération, ou dividendes pour les TNS), certaines prestations sociales sont, en effet, conditionnées au versement d’un minimum de cotisations.
Exemples :
- Retraite : il est nécessaire de cotiser sur une base d’au moins 600 SMIC horaire, soit environ 7 100 €, pour valider 4 trimestres de retraite par an. Le TNS peut percevoir cette somme en une seule fois et valider ses 4 trimestres d’un coup tandis qu’un assimilé salarié doit la percevoir sur deux mois au minimum.
- Indemnités journalières : les assimilés salariés doivent toucher au moins 2030 SMIC horaire, soit environ 24 700 €, pour avoir droit aux indemnités journalières en cas d’arrêt de travail.
De plus, si vous n’avez pas de revenu professionnel, ou s’il est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit environ 9 400 €, et que vous percevez des revenus du patrimoine (dont les dividendes) supérieurs à 50 % du PASS (soit environ 23 500 €), vous devez payer la cotisation subsidiaire maladie. Cette taxe finance la protection universelle maladie (PUMA).
La clé pour optimiser est donc de combiner rémunération et dividendes. Il n’existe pas de répartition optimale absolue entre ces deux modes de rémunération. Il est donc nécessaire de réaliser des simulations pour déterminer le montant et la répartition qui vous conviendront le mieux.
BON À SAVOIR : allocations chômage et rémunération
Si vous lancez votre entreprise tout en percevant l’allocation retour à l’emploi de (ARE), sachez que vous rémunérer réduit le montant de votre chômage. Dans la pratique, même les dividendes (soumis ou non aux cotisations sociales) peuvent faire baisser l’allocation. Il est donc conseillé de conserver les bénéfices dans l’entreprise et de ne les distribuer qu’une fois vos droits au chômage épuisés.
- 3 – Envisager d’autres modes de rémunération
La rémunération et les dividendes sont les deux principaux modes de rémunération du dirigeant mais, il existe d’autres options :
|
Mode de rémunération |
Impôt sur le revenu |
Cotisations sociales |
| Les avantages en nature : la société vous fournit des biens ou services pour faciliter votre travail, comme un véhicule de fonction ou un téléphone. Certaines dépenses personnelles peuvent aussi être prises en charge, comme les cotisations sociales dues sur votre rémunération ou vos dividendes. |
✅ Catégorie des traitements et salaires |
✅ |
| Les remboursements de frais : si vous avancez des frais professionnels (frais kilométriques, repas d’affaires, etc.) la société peut vous rembourser.
Attention : les dépenses doivent être engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et non dans votre intérêt personnel. |
❌ | ❌ |
| La rémunération du compte courant d’associé : vous pouvez être amené à prêter de l’argent à votre société, c’est ce qu’on appelle un apport en compte courant d’associé. Ce prêt a vocation à être remboursé par la société et peut être rémunéré par le versement d’intérêts. |
✅ Catégorie des revenus de capitaux mobiliers (PFU ou barème de l’IR + prélèvements sociaux à 17,2 %) |
❌ |
| La location de tout ou partie de locaux : vous pouvez louer des locaux à votre société, que ce soit une pièce de votre maison utilisée comme bureau ou un local entier. Ces locaux doivent être utiles à l’activité professionnelle. La location peut être nue (sans équipements) ou équipée (avec le mobilier et matériel nécessaire, un peu comme de la location meublée pour des locaux à usage d’habitation). |
✅ Location nue : catégorie des revenus fonciers (barème de l’IR + prélèvements sociaux à 17,2 %) Location équipée : catégorie des BIC (barème de l’IR) |
Location nue : ❌ Location équipée : ✅ |
Seules les sommes soumises aux cotisations sociales ouvrent des droits à la retraite et à d’autres prestations sociales.
- 4 – Profiter de l’épargne salariale
Enfin, si vous employez au moins 1 salarié et moins de 250 salariés, vous pouvez profiter, au même titre que vos salariés, de la majorité des dispositifs d’épargne salariale : intéressement, participation, plan épargne entreprise (PEE), plan épargne retraite entreprise (PERE)).
Les assimilés salariés qui cumulent leur fonction avec un contrat de travail peuvent également bénéficier de la prime de partage de la valeur (PPV) et du plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE).
BON À SAVOIR :
Depuis le 1er janvier 2025, les entreprises qui emploient entre 11 et 49 salariés doivent mettre en place l’un de ces dispositifs dès lors qu’elles réalisent, 3 années de suite, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires. Selon la solution choisie, vous pourrez également en bénéficier.
Si elle est investie dans un PEE ou dans un PERE, l’épargne salariale est exonérée d’impôt sur le revenu. Selon le dispositif et la taille de la société, elle bénéficie également d’un allègement, voire d’une exonération de charges sociales. En revanche, vous n’acquérez aucun droit à retraite ou à protection sociale.
L’épargne salariale est donc une solution très efficace et peu coûteuse (en impôts et cotisations sociales) pour compléter votre rémunération.
En résumé, vous disposez d’une large palette pour constituer votre rémunération. La manière dont ces options s’articulent varie selon chaque situation, d’où l’importance d’être accompagné par votre conseiller pour faire les choix les plus adaptés à vos besoins.
Vous êtes dans une situation financière difficile à la suite d’un arrêt maladie qui se prolonge, d’une invalidité ou du décès d’un proche ?
Pour vous aider, voici 5 conseils utiles en fonction de votre situation :
|
Ma situation / |
En arrêt maladie |
En invalidité |
Décès d’un proche |
|
1. Demander les prestations des régimes de prévoyance obligatoires et complémentaires |
Obtenir les indemnités journalières du régime obligatoire et de l’assureur (contrats de prévoyance souscrits par l’entreprise ou vous-même) |
Obtenir la pension d’invalidité du régime obligatoire et de l’assureur (contrats de prévoyance souscrits par l’entreprise ou vous-même) |
Obtenir les capitaux décès et/ou une rente du régime obligatoire et de l’assureur (contrats de prévoyance souscrits par l’entreprise ou le défunt) + pension de réversion pour le conjoint |
|
2. Vérifier les contrats d’assurance de prêts immobiliers |
Prise en charge de tout ou partie des échéances d’emprunt (si la garantie incapacité est souscrite) |
Prise en charge de tout ou partie des échéances d’emprunt, voire un remboursement définitif du capital restant dû (en fonction du degré d’invalidité) |
Remboursement définitif du capital restant dû à hauteur de la quotité d’assurance du défunt |
|
3. Débloquer votre PER ou anciens contrats retraite (Madelin, PERP, Article 83, etc.) en franchise d’impôt sur le revenu |
Non, mais prise en charge possible des cotisations par l’assureur pour les indépendants (si la garantie incapacité est souscrite) |
Possibilité de débloquer les capitaux de votre contrat en cas d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie* |
Possibilité de débloquer les capitaux de votre contrat en cas de décès de votre conjoint ou partenaire de PACS |
|
4. Débloquer votre épargne salariale (PEE ou PERCO) en franchise d’impôt sur le revenu |
Non |
Possibilité de débloquer les capitaux de votre contrat en cas d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie* |
Possibilité de débloquer les capitaux de votre contrat en cas de décès de votre conjoint ou partenaire de PACS |
|
5. Revente des placements de défiscalisation (Pinel, Denormandie, Scellier, parts de FIP/FCPI, etc.) sans remise en cause de l’avantage fiscal |
Non |
Oui, il est possible de ne pas respecter son engagement de location, de conservation en cas d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie* |
Oui ou reprise possible de l’avantage fiscal si vous êtes le conjoint ou partenaire de PACS du défunt et attributaire du bien |
*En tant qu’invalide, vous êtes affecté à une catégorie d’invalidité parmi les 3 définies par la Sécurité sociale :
- la 1ère catégorie est l’incapacité d’exercer une activité professionnelle rémunérée ;
- la 2ème catégorie est l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle rémunérée ;
- la 3ème catégorie est l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle rémunérée et l’obligation d’être assisté par une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
N’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informations, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Enfants et droits à la retraite : parents gagnants ?
Avoir des enfants, les adopter ou les élever vous offre des avantages pour la retraite ! Entre trimestres supplémentaires et majorations, faisons le point sur les principaux droits et leurs conséquences sur votre future pension de retraite.
La validation de trimestres
Vous pouvez valider jusqu’à 4 trimestres par an. Ces trimestres déterminent si votre pension de retraite est à taux plein ou avec une décote.
Exemple : pour les salariés nés à compter de 1965, la retraite peut être liquidée à taux plein si 172 trimestres sont validés.
Même pendant votre congé maternité ou d’adoption (pendant lequel vous ne cotisez pas), vous pouvez valider destrimestres « assimilés » :
- pour les congés intervenus depuis le 1er janvier 2014: un trimestre est validé par période de 90 jours d’indemnisation ;
- avant 2014: seul le trimestre civil au cours duquel a eu lieu l’accouchement est retenu et aucun trimestre n’est retenu pour l’adoption.
Des trimestres de majoration de la durée d’assurance (ou trimestres « bonus ») sont aussi attribués aux parents ayant eu/adopté et éduqué un enfant :
- 4 trimestres pour la naissance ou l’adoption ;
- 4 trimestres pour l’éducation
Soit 8 trimestres au total par enfant.
Ces trimestres vont généralement à la mère, mais pour les enfants nés ou adoptés depuis le 1er avril 2010, les parents peuvent demander à répartir entre eux les trimestres adoption et éducation sous conditions. Si vous avez pris un congé parental d’éducation ou si votre enfant est en situation de handicap, vous pouvez aussi obtenir des trimestres supplémentaires.
BON À SAVOIR :
Les trimestres de majoration pour naissance, adoption, éducation, congé parental ou enfant handicapé n’apparaissent pas dans votre relevé de carrière ou relevé individuel de situation (RIS). Ils doivent être ajoutés lors de la demande de retraite.
Les majorations de la pension
Si vous êtes nés à compter de 1964, que vous bénéficiez d’au moins 1 trimestre de majoration (pour naissance, adoption, éducation, congé parental ou enfant handicapé) et que vous avez validé les trimestres nécessaires avant l’âge légal, vous pouvez avoir une surcote parentale de 2,5 % par trimestre travaillé avant cet âge.
Exemple : si vous êtes né à compter de 1968 et que vous réunissez 172 trimestres dès 63 ans, alors les trimestres travaillés jusqu’à votre âge légal de départ de 64 ans vous donnent droit à surcote parentale.
Si vous avez eu ou élevé 3 enfants ou plus, votre retraite de base bénéficie d’une majoration de 10 %. Cette majoration s’applique aussi à la pension de réversion après le décès de votre conjoint(e). La surcote parentale et la majoration de 10 % sont cumulables.
BON À SAVOIR :
Les conditions varient selon le régime de retraite (notamment les régimes complémentaires) auquel vous êtes affilié, et des règles spécifiques existent si vous avez travaillé sous plusieurs régimes.
Départ à l’étranger : nos conseils pour un voyage serein !
Vous partez vivre à l’étranger et vos valises sont faites ? Voici nos conseils pour optimiser la gestion de votre patrimoine à l’occasion de votre départ.
Que deviennent vos placements ?
Même si vous quittez la France, vous pouvez conserver vos placements en France : contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, investissements locatifs, PEA, comptes-titres, PER, etc. Toutefois, le traitement fiscal et social des revenus de ces placements change :
- Sur le plan fiscal : votre imposition dépend de la convention fiscale entre la France et le pays de votre destination. En l’absence de convention, vos revenus peuvent être imposés deux fois.
| Pensez à prévenir de votre départ l’administration fiscale dès que possible. |
- Sur le plan social : vous payez des prélèvements sociaux uniquement sur les gains et les revenus immobiliers (loyers, plus-values immobilières) au taux de :
- 7,5 % selon votre pays d’accueil, et si êtes affilié obligatoirement à un système de sécurité sociale dans ce pays ;
- 17,2 % si vous restez affilié à la sécurité sociale en France.
Et vos investissements de défiscalisation ?
Vos réductions et crédits d’impôt passés ne sont, en principe, pas remis en question : le passé est figé ! En revanche, ils ne réduiront plus votre impôt futur.
Si vous continuez à verser sur un contrat d’épargne retraite (PER, PERP, Madelin, etc.), vous devez indiquer que vous renoncez à la déductibilité des versements !
Retraite à l’étranger : ce qu’il faut savoir
Si vous êtes retraité, vous continuez de percevoir votre pension sous réserve d’envoyer un certificat de vie (par courrier postal ou en ligne) à l’assurance retraite chaque année.
En tant que non résident, vous êtes exonéré de la CSG, de la CRDS ainsi que de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (de 0,3 %) sur votre pension.
Si vous percevez l’ASPA ou l’ASI, ces allocations ne vous seront plus versées.
Travailler à l’étranger : quelle couverture sociale ?
Si vous travaillez à l’étranger, vous relevez en principe de la Sécurité sociale locale et devez déclarer votre transfert de résidence sous un mois.
Vous pouvez compléter votre couverture en cotisant volontairement à la Caisse des Français de l’Étranger. En revanche, en cas de détachement par un employeur français, vous restez affilié à la sécurité sociale française.
Et mon conjoint dans tout ça ?
Si vous êtes marié ou pacsé, consultez un notaire pour prévoir les conséquences d’un divorce ou d’un décès pendant votre séjour à l’étranger.